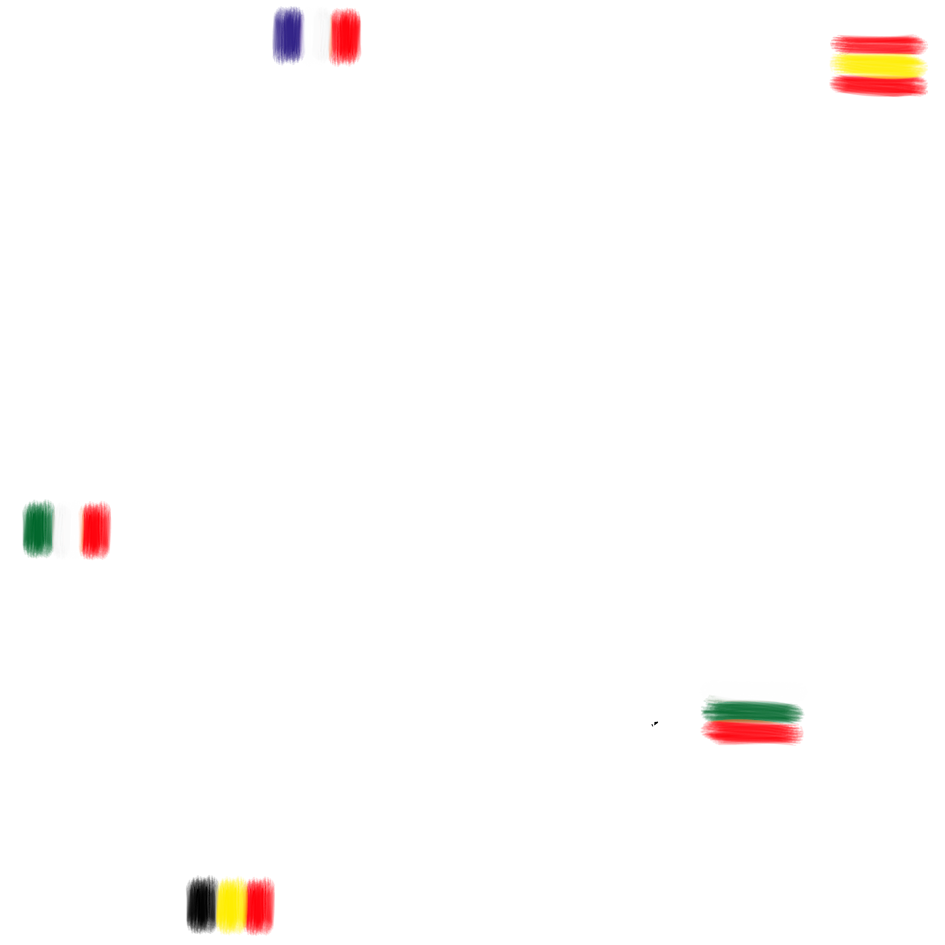
La cause de l’Autisme : Séminaire Européen
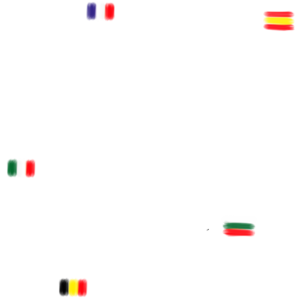 Séminaire Européen d’échange sur le travail
Séminaire Européen d’échange sur le travail
avec les enfants et jeunes atteints de TSA
Les bonnes pratiques dans le travail avec les enfants et les jeunes atteints de TSA
I. Une pratique qui convient au sujet
L’objectif principal de ce séminaire est de prendre comme point de départ, l’exposition de différentes pratiques et expériences développées au sein des organisations participantes, afin de définir la spécificité de leur approche clinique et d’établir les éléments, communs ou spécifiques à chacun d’entre eux, qui peuvent être considérés comme des « bonnes pratiques » dans le travail d’accompagnement avec les enfants et les jeunes atteints de TSA.
Dans l’état actuel des connaissances et des résultats de la recherche scientifique liée à l’autisme, il est conseillé d’adopter dans le travail avec les enfants et les jeunes atteints de TSA, une position prudente et d’opter pour des réponses établies dans un consensus entre les professionnels et les familles. Après plus de cinquante années de recherche, les découvertes –que ce soit sur les causes, la présence et la progression des symptômes ou sur les traitements- restent très limitées. Cette précaution et engagement pour le dialogue, ne sont pas contradictoires avec les progrès de la science dont les travaux s’orientent de plus en plus vers l’affirmation des causes multifactorielles : génétiques, épi-génétique, biologiques, environnementales─ et diverses autres causes caractérisées par la plasticité neuronale et en lien avec la singularité de chacun.
Des rapports récents sur les « bonnes pratiques cliniques » (1) sur l’autisme, indiquent qu’actuellement il n’y a pas une « bonne pratique » en ce qui concerne le soutien ou le traitement psychosocial des enfants atteints de TSA. A la différence du traitement de certaines maladies qui relèvent du domaine de la médecine, actuellement il n’existe pas de preuve scientifique telle pour pouvoir établir de recommander à tous les enfants atteints de TSA un traitement unique et en assurer l’efficacité. De même, les études réalisées à ce jour, qui cherchent démontrer l’efficacité d’un seul type de traitement, souffrent d’un certain nombre de biais méthodologiques qui limitent grandement la pertinence de ses résultats.
L’approche clinique des organisations participantes au Séminaire européen, ont en commun une position éthique qui constitue la base de leurs stratégies thérapeutiques et l’idée que l’enfant autiste est un « sujet » à l’œuvre. Ce qui implique un respect absolu de leur singularité et par conséquent, une approche individuelle du cas par cas basé sur l’accompagnement et la collaboration entre l’enfant et l’adulte partenaire qui tient compte des préférences, des choix, des inventions et des solutions trouvées par l’enfant lui-même.
Ce respect et cette considération pour le caractère unique de chaque enfant et de chaque intervenant, considéré comme la marque d’un style personnel, est le moteur du travail avec l’enfant et à partir de quoi, nous développerons ce qui peut être reconnu comme « des bonnes pratiques », des pratiques qui seront les mieux indiquées pour travailler ce qui est en jeu pour l’enfant autiste.
À la lumière de cette approche de départ, nous travaillerons sur les différents aspects qui peuvent être promus comme étant des bonnes pratiques dans le travail avec les enfants et les jeunes autistes et avec leurs familles : la fonction de l’accueil dans les institutions qui travaillent avec les enfants et les jeunes autistes, condition préalable pour qu’un traitement soit possible; l’importance et la difficulté du diagnostic précoce; modalités de traitement de la petite enfance et sa continuité dans le parcours de soins; attention au moment crucial de l’adolescence de ces enfants; stratégies pour l’âge adulte; travailler avec les parents tout le long du suivi dans chacun des différents âges de la vie.
II. Les difficultés et les risques pour établir ce qui pourrait être une « bonne pratique » dans le travail avec les êtres humains, autistes ou non.
L’utilité, la nécessité et l’importance de certaines procédures de vérification appliquées aux procédés de fabrication et de la production, ou la finition du produit dans le domaine de l’industrie et des domaines similaires de l’activité humaine, n’est pas mise en doute. Par exemple, les déterminations analytiques de la microbiologie, des matériaux inorganiques, etc., dans le processus de préparation de certains aliments, sont des procédures essentielles pour la viabilité de ceux-ci. Si l’on ajoute à cela la mise en place de mécanismes de contrôle pour assurer l’application régulière de ces procédures, nous décrivons un aspect de ce qu’on appelle la gestion de la qualité appliquée à l’industrie alimentaire.
La méthodologie de ces procédures de détermination microbiologique peut être appliquée sans problème à d’autres domaines, par exemple, pour contrôler antisepsie d’une salle d’opération ou du matériel chirurgical d’un hôpital, mais si nous essayons de les appliquer à certains domaines de la santé sociale ou de la pratique éducative, il est tout simplement impossible, inapproprié. Et quand cette impossibilité est forcée, le résultat ne peut être que de la tromperie ou le fraude.
Le forçage dans l’application de la méthodologie propre au discours du contrôle de la qualité et de ses certifications, aux certains procédés des méthodologies de l’intervention sociale, sanitaire et éducative, est la tentative d’éviter, d’esquiver et d’escroquer cette impossibilité inhérente en lien avec l’humain. Et cela depuis le début où il s’agirait de contourner la difficulté même d’établir les critères et les indicateurs par de la pure évaluation.
Cette tendance et ce forçage vers la standardisation qui cherche à être imposée de manière autoritaire, comme étant le seul recours acceptable, dévoile une conception de ce qui veut être évalué et soumit à un contrôle de qualité, d’une conception des relations humaines, du social, de la manière comme ses mouvements surgissent dans le sujet depuis les premiers moments de la vie, dans sa relation à son environnement, à ses semblables et au monde qui l’entoure. Une conception aussi de la condition humaine et de la souffrance humaine.
Les relations humaines ont une différence qualitative fondamentale avec le reste de systèmes de relation que nous connaissons, au sein de chaque espèce et entre différentes espèces, ce trait différentiel est la variabilité, la diversité, la spontanéité et la créativité, la capacité d’improvisation et d’innovation, tous de traits qui reposent précisément dans l’inexacte, dans le désajustement, dans le malentendu structurel propre à notre système de communication : le langage humain dans tout son ampleur et en ce qu’il implique du corps de l’être parlant. Sans ces traits il n’y a pas de l’humain, il y a qu’une machine.
Parler de « bonnes pratiques » dans le travail avec des enfants et des jeunes qui présentent les difficultés liées à ce que qui est communément appelle le TSA, veut dire pour nous, d’opposer une résistance au forçage, effronté et menaçant qui cherche à imposer une pratique dévastatrice qui se désintéresse de tout ce que de la souffrance n’entre pas dans les moules rigides et grossiers dans lesquels on essaie de la ranger, sous les hospices du handicap ou de ce qui dérange. Pour nous au contraire, cela veut dire chercher, actualiser, mettre à l’épreuve et promouvoir les pratiques qui respectent les conditions essentielles dans lesquelles peut se manifester l’humanité, pour que ces dites pratiques, répondent aux difficultés que présentent ces enfants et ces jeunes.
Les organisations et les institutions qui participent à ce séminaire ont développé et mis en pratique depuis quelques décennies, une série de pratiques et orientations qui se sont avérées respectueuses envers la manière si particulière que chaque enfant a de répondre à ses difficultés. Ces pratiques répondent à la fois au traitement des dites difficultés rencontrées et à l’établissement des relations thérapeutiques profitables au travail avec les familles (mères, parents, frères, et grands-pères, parfois), sont également appropriées pour promouvoir l’intérêt au savoir et l’envie d’apprendre chez l’enfant. Elles permettent aussi d’établir et maintenir la relation éducative avec les instituteurs, les éducateurs et avec tout celui qui saura adopter avec eux, une position de savoir ne pas savoir.
La vérification à propos de ce qui est le plus convenable et le meilleur, l’intérêt de sonder comment il est fait, et pour établir comment le faire de la manière la plus correcte et pertinente possible, c’est un intérêt propre à l’humain, aussi propre que la rigueur qui convient à une telle tâche. Cette rigueur devrait pouvoir nous empêcher de prendre certains raccourcis, comme celui de prétendre changer notre pratique dans les institutions, pour une affaire dicté par un protocole. Jacques-Alain Miller (2) signale cette tendance comme la passion nord-américaine du « how to » : « chaque chose dans le monde, chaque activité dans le monde est susceptible d’avoir un » how to « , comment, le faire …, on peut avoir un comment conduire une automobile, mais de là à savoir comment se conduire avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, avec les astres, avec soi-même, avec le corps… » Cette différence, ce pas de plus est celui que nous prenons soin de ne pas forcer, de ne pas escamoter là où le discours de la gestion de la qualité avec sa proposition de formalisation généralisée n’est pas une vérité qui cherche à savoir, mais à s’imposer.
______________
(1) Voir le travail réalisé dans Antenne 110
(2) Miller, J.A., Structure, développement et histoire. Gelbo. Bogotá 1999.

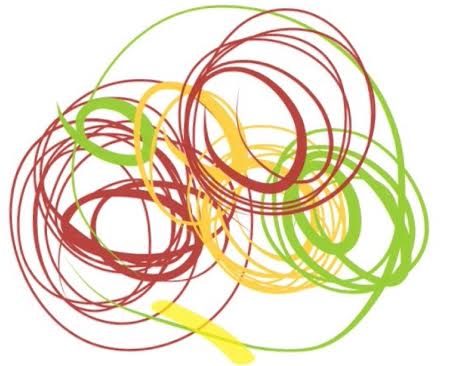
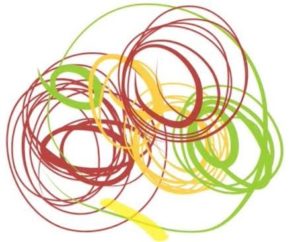 La vérité sur l’autisme – par Vilma Coccoz
La vérité sur l’autisme – par Vilma Coccoz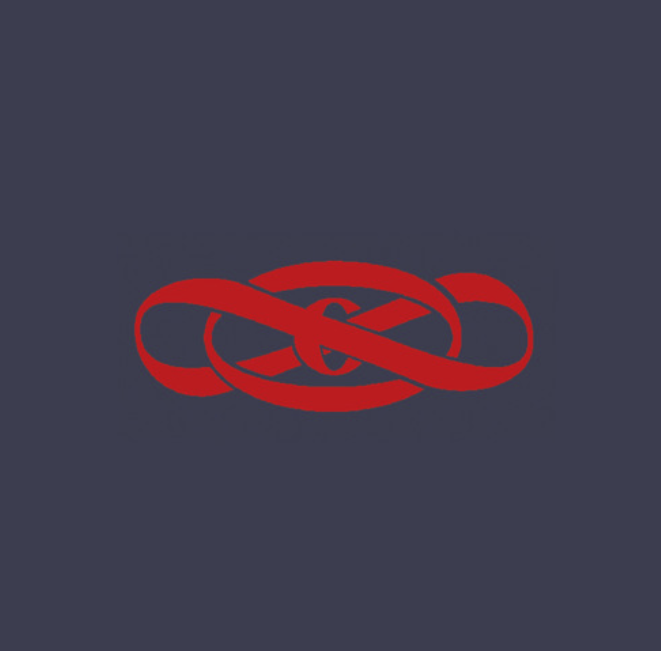


 L’échec temporaire d’une propagande par Gil Caroz, vice-président de l’ECF
L’échec temporaire d’une propagande par Gil Caroz, vice-président de l’ECF